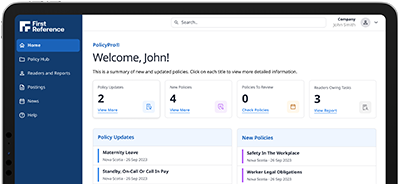Les agences de placement de personnel continuent d’être dans la mire du fisc.
Occasional Contributors
Nous avons depuis quelque temps été témoins d’interventions plus musclées de la part des autorités fiscales à l’encontre des travailleurs (ou leurs sociétés) qui contractent avec des agences de placement de personnel aux fins de la prestation de services à leurs entreprises-clientes. L’impact de la récente décision de la Cour d’appel du Québec (17 juillet 2014) relativement à l’agence Océanica , bien que visant le secteur des infirmiers, se fera sentir dans tous les secteurs.
Les cotisations sont à la fois personnelles et corporatives. Dans le dernier cas, les autorités fiscales invoquent les règles en matière « d’entreprises de services personnels ».
Un pâté chinois de définitions
En matière d’impôts sur le revenu, la Loi sur les impôts (la « Loi ») prévoit des définitions fort laconiques eu égard aux « employés » et « employeurs ». Un « employé » signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge. Un « employeur » signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération. Certes brillant par la simplicité, mais baignant dans l’imprécision.
Les définitions prévues dans les autres lois en matière d’assurance-maladie, du régime des rentes du Québec, de l’assurance parentale, des normes du travail, du code du travail, de la sécurité au travail (et j’en passe) sont largement insatisfaisantes. Et elles diffèrent l’une de l’autre non seulement en matière de nomenclature mais aussi de concepts. C’est ainsi à titre d’exemple que la Loi sur les normes du travail exclut le « cadre supérieur » de la notion de « salarié ».
L’objet commun, toutefois, de toutes ces définitions est d’établir qui est assujetti aux lois en question et ce dans l’atteinte des objectifs sociaux prévus.
Le Triangle des Bermudes (version Québec)
Le Triangle des Bermudes est une zone géographique imaginaire de l’océan Atlantique qui, selon les légendes, serait le théâtre d’un grand nombre de disparitions de navires et d’avions.
Nous avons notre propre triangle en matière de relations d’emploi. Celui-ci est formé de trois parties soit (a) le fournisseur d’un service, (b) une agence de placement de personnel et (c) une entreprise-cliente de l’agence. Plutôt que d’engendrer la disparation d’avions, le triangle québécois est appelé, dans la mêlée de Océanica, entre autres, à faire disparaître (transformer) un grand nombre de travailleurs « autonomes » qui s’aventurent à l’intérieur de sa charpente.
Mise en scène
Factuellement, la situation est simple. Voyons un exemple dans le secteur de la santé, objet non seulement de Océanica, mais de l’actualité québécoise compte tenu de la réforme « Barrette » en cours.
Une agence de placement de personnel contracte avec une entreprise cliente : un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou un centre local de services communautaire (CLSC). Du même coup, l’agence contracte avec le travailleur-infirmier pour fixer les modalités du travail dont l’emplacement, les heures de travail et la rémunération. Si l’infirmier est incorporé, le contrat est passé par l’agence avec la société du travailleur.
Malgré la simplicité des faits, la qualification juridique des relations en cause et des participants est une boîte de pandore, une « disharmonie » comme il a été dit. Les questions fusent. Le travailleur est-il employé de l’agence de placement ou du centre hospitalier? Qui subit la responsabilité des charges fiscales québécoises (impôts, RRQ, RQAP, FSS, CNT). L’agence est-elle tenue de déduire des impôts à la source? Qu’arrive-t-il de la présence d’une société incorporée par le travailleur?
C’est sur toute cette problématique juridique que s’est penchée la Cour d’appel du Québec dans Océanica.
Salarié ou travailleur autonome?
La Cour d’appel fut appelée à trancher, inter alia, sur la question suivante : le personnel infirmier recruté par l’agence de placement afin de travailler chez ses entreprises-clientes était-il salarié ou travailleur autonome?
En l’occurrence, la Cour conclut qu’il s’agissait de salariés, pour les motifs suivants:
Les travailleurs n’effectuaient pas leur travail à leur guise. S’ils acceptaient un placement, ils devaient se plier strictement à l’horaire des clients. Ils s’intégraient dans la structure hiérarchique des clients.
Les clients avaient le libre choix des moyens d’exécution des contrats et des rythmes d’exécution.
Les chances de profits ou de perte des travailleurs étaient inexistantes. Ils n’encouraient aucun risque financier, étant rémunérés selon un taux horaire convenu.
Ils effectuaient leur travail sous la direction et le contrôle de l’entreprise-cliente. Ils étaient intégrés dans la structure organisationnelle des clients, tant du point de vue hiérarchique, des protocoles de soins à observer, de l’assignation du travail, de l’horaire de travail et de l’évaluation du travail.
Les éléments caractéristiques du contrat de services ou d’entreprise étaient absents, notamment le libre choix des moyens d’exécution, du rythme d’exécution et le risque de perte et la chance de profit.
La Cour constata que, dans toutes les lois en cause dans cet arrêt, un « employeur » est défini comme la personne qui verse la rémunération aux employés. Elle observa aussi que, dans Pointe-Claire c. Québec (1997) 1 R.C.S. 1015, la Cour Suprême statua, en matière d’une demande d’accréditation en vertu du Code du travail, que si le travailleur reçoit une contrepartie financière de quelque personne qui en assume la charge financière, le payeur est son employeur et le récipiendaire son employé.
Le Cirque du Soleil
Je me permets respectueusement les commentaires suivants :
Le raisonnement de la Cour d’appel reflète une gymnastique intellectuelle qui n’a pas sa place en droit fiscal. Si on peut accepter que les concepts fonctionnels élaborés dans l’arrêt Pointe-Claire c. Québec (supra) ont leur place en matière du Code du travail aux fins de l’assemblage représentatif d’unités d’accréditation syndicales, une telle application est une aberration en droit fiscal. Pour employer les mots de Madame la Juge Claire l’Heureux-Dubé en dissidence dans Pointe-Claire, le résultat est en fait « absurde ».
Le droit fiscal est exorbitant du droit commun. Il s’accroche sur les contrats existants. Il ne fabrique pas et ne présume pas l’existence de relations contractuelles valablement formées de bonne foi et sans stratagème.
La relation entre un employeur et un employé est contractuelle. Tout ce qui importe donc, dans des relations tripartites, est de qualifier la relation sur un base bipartite.
En l’espèce, il existait un premier contrat entre le travailleur et l’agence de placement. Ce contrat pouvait être qualifié de contrat de travail ou de contrat d’entreprise, la qualification en l’occurrence étant fonction des critères énoncés par la jurisprudence, dont dans 671122 Ontario Ltd. v. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] R.C.S.. 983 et Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., [1986] 3 F.C. 553.
Il existait aussi un second contrat, soit un contrat d’entreprise, entre l’agence de placement et son entreprise-cliente. Toutefois, aucun contrat n’existait entre le travailleur et l’entreprise-cliente. À fortiori donc, on ne pouvait prétendre aux fins fiscales à l’existence d’une relation entre l’entreprise-cliente et le travailleur ayant pour effet d’influer sur son statut fiscal.
Le travailleur qui reçoit sa paye d’une l’agence de placements ne la reçoit pas de l’entreprise-cliente. Certes que l’agence de placement emploie à cette fin sa rémunération de la part de son entreprise-cliente, mais le paiement par l’entreprise-cliente à l’agence est fonction de son contrat avec l’agence, auquel le travailleur n’est pas partie. Bien que l’entreprise-cliente exerce un contrôle fonctionnel et opérationnel sur les actes du travailleur, ceci n’est exercé que dans l’exécution de son contrat avec l’agence de placements, et non en vertu d’un contrat de travail avec le travailleur.
Prétendre autrement serait de semer la zizanie dans toutes les relations commerciales tripartites. Prenons à titre d’exemple tout bureau de professionnels (comptables, avocats, ingénieurs, architectes ou autres) qui s’engage à titre d’intégrateur de projets à rendre un éventail de services à une entreprise-cliente en faisant appel à des sous-traitants. Si nous suivons la piste de la Cour d’appel, le statut fiscal des sous-traitants serait fonction du degré de contrôle exécuté par l’entreprise-cliente sur le sous-traitant aux fins de l’exécution du mandat avec le bureau professionnel. En d’autres mots, puisque l’entreprise-cliente dispose de la liberté d’orienter le travail à sa guise en vertu de son Devis avec l’intégrateur, les travailleurs seraient présumés être employés du bureau professionnel. Et les parties pourraient en matière de droit de l’emploi et de droit fiscal exposés à des arguments de la présence de « double employeurs »?
L’application en l’espèce par la Cour d’appel du lien de subordination est, avec respect, mal fondée. Tout contrat de service comporte un élément de contrôle par le client. Le consultant ou professionnel qui accepte d’assumer certaines tâches financières ou juridiques pour un client peut-il être dit être complètement à l’abri de contrôle sur l’exécution de son travail? Bien sûr que non. Si le devis de travail est bien fait, le client se réservera le droit de diriger les tâches du consultant. Alors pourquoi serait-ce différent pour l’infirmière contractuelle de 30 ans d’expérience, placée par une agence, à qui on confie certains patients? Comme le prône la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Pointe-Claire (supra), une approche plus « globale » qu’une appréciation restrictive du lien de subordination se doit d’être suivie.
L’espoir d’une incorporation?
En dépit des réserves exprimées ci-dessus, on peut prévoir que Océanica (supra) s’avérera en pratique une forte côte à remonter en matière de cotisations. À moins, évidemment, qu’une autre affaire mène la Cour d’appel à préciser sa pensée, ou que la Cour Suprême ne le fasse. Une requête pour permission d’appeler dans Océanica n’a pas été déposée à la Cour Suprême du Canada.
Dans l’espoir d’une avenue alternative, je pose maintenant la question suivante : le travailleur se disant autonome qui contracte avec une agence de placement aurait-il une meilleure protection s’il se constituait en société par actions, et ce malgré les règles en matière d’entreprises de services personnels?
Sur cette question, je formule les commentaires suivants :
La Loi répute l’existence d’une entreprise de services personnels lorsque l’employé de la société cible « pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne à qui il a fourni les services si ce n’était de l’existence de la société ». Aux fins de l’application de cette règle, il devient donc primordial d’établir qui est la personne à qui les services sont fournis.
Dans une relation bilatérale, la personne à qui les services sont fournis par un travailleur est son entreprise-cliente. Mais, dans une relation tripartite (triangulaire) formée de la société du travailleur, d’une agence de placement et de l’entreprise-cliente, il m’appert bien fondé de soutenir que la personne à qui la société du travailleur fournit les services est bien l’agence de placement, et non l’entreprise-cible. Il convient de noter aux fins de cette analyse que la notion de « fourniture » n’est en matière d’impôts sur le revenu pas aussi développée qu’en matière de TPS et de TVQ. Mais si on peut s’inspirer des principes en TPS et TVQ, on peut conclure à la présence de deux fournitures distinctes, soit la première entre la société du travailleur et l’agence, et la deuxième entre l’agence et son entreprise-cliente. Et ceci ne serait altéré du fait d’une relation de contrôle du travail par l’entreprise-cliente. Ceci m’appert être la bonne conclusion en droit, compte tenu entre autres des liens contractuels créés.
Il n’en demeure toutefois pas moins que, même si toute fourniture est présumée être faite à l’agence de placements, on ne pourra éviter de plaider, afin d’éviter d’être une entreprise de services personnels, que l’employé incorporé ne serait par ailleurs pas employé de l’agence.
Conclusion
Si une conclusion simpliste m’est permise, la voici : Océanica a jeté tout un pavé dans la marre des travailleurs incorporés qui transigent avec des agences de placement.
Mais une lueur d’espoir existe pour les travailleurs incorporés.
Par Me Michel Paul Coderre est avocat-fiscaliste à Montréal. Il pratique au sein du cabinet Rochefort et Associés. Vous pouvez le rejoindre au 514-814-6886.
Table of Contents
Compliance Made Easy®